L’un des buts de ZionKabbalah.com est la destruction, l’annihilation complète et définitive du Messianisme, qu’il soit chrétien ou juif, afin d’amener au Monde la Délivrance Finale. Aucune peuple ne peut prétendre être « Supérieur », « Élu », … aucune personne ne peut prétendre être « Roi des Juifs », « Grand Monarque », …
Le monde doit sortir de cette « maladie mentale », ce « syndrome de Jerusalem », maladie typiquement « masculine » car la Dimension Féminine du Divin est voilée pendant l’exil.
Seul Dieu est Roi.
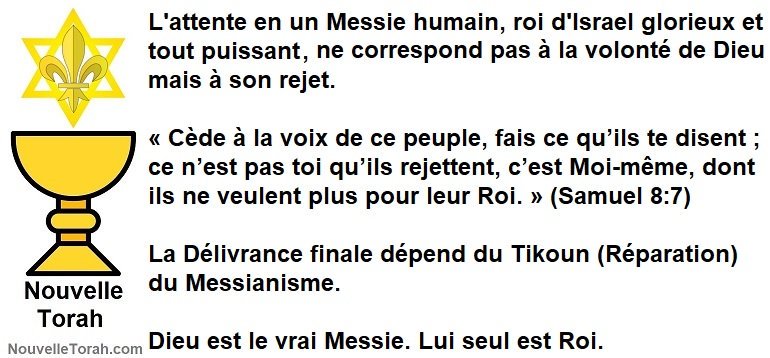
« Melekh HaMachiah » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח
Guematria = 453
« HaSkizophrenia » (« La Schizophrénie »)
הסכיזופרניה
Guematria = 453
#DieuEtLHomme #Bipolarité
Le vrai Messianisme, c’est l’union de l’En Haut et de l’En Bas, des noms de Dieu YHVH et Elohim.
YHVH (26) + Elohim (86) = 112
Guematria de Machiah en transformation ATBASH (valeurs inversées) = 112
Dieu est UN.
Lorsque nous brisons la barrière entre matériel et spirituel, lorsque YHVH et Elohim sont unis, nous pouvons tous faire descendre en nous-mêmes une âme très haute, c’est cela à notre sens ce que nous appelons « Machiah ». Machiah est une sorte d’âme collective, et non un être en particulier.
Sur ZionKabbalah.com, vous trouverez des enseignements et des informations destinées à « ouvrir les yeux ». Nous ne prétendons pas détenir la vérité, mais souhaitons partager les résultats de nombreuses années de recherches. Comme vous pouvez le remarquer, l’immense majorité des enseignements publiés sur ce site sont « voilés », pour plusieurs raisons, à la manière de la Torah qui est un ensemble de « jeux de mots » et de « calculs ».
Les Évangiles sont des récits de type midrachique, originellement en hébreu, dont les paraboles traitent de la Délivrance. Lus à la lumière de l’hébreu et de la Kabbalah, les récits des Évangiles nous permettent de mieux comprendre le schisme provoqué il y a 2000 ans. Pris à la lettre, ces récits ont constitué la base du Christianisme, le plus gros mensonge de l’Histoire, et des abominations qui suivirent (guerres, esclavage, etc.).
Les dirigeants du Peuple Juif sont coupables de ne pas avoir su endiguer le fléau du Messianisme depuis l’époque du Roi Saul. Il n’aurait jamais du y avoir de roi humain à la tête du Royaume d’Israel.
Les dirigeants du Peuple Juif sont complices. Ne trouvez-vous pas étrange qu’à part quelques passages obscurs, rien dans le Talmud n’est écrit sur le schisme entre Judaïsme rabbinique et Christianisme ?
« Salut » / « Délivrance » se dit « Yeshoua » en hébreu. « Yeshoua » a donné « Jésus » en français.
« Yeshoua » représente la personnification de la Délivrance Finale et de nombreux récits écrits il y a environ 2000 ans parlent de ce sujet. Le Talmud nous enseigne que les « temps messianiques » ont commencé il y a 2000 ans. Cependant, les « kelim » (récipients spirituels) n’étaient pas prêts et cela a eu pour conséquence un gros « balagan » (« désordre » en hébreu).

La compréhension des événements qui se produisirent il y a 2000 ans est l’une des clés du Tikoun amenant à la Gueoula. C’est un terrain miné, car les conclusions que l’on en tire sont loin de plaire aux « religieux » et demande beaucoup d’humilité, notamment pour les Juifs et les Chrétiens. Pour quoi ? Car pour résumer en quelques mots nos conclusions : 1) Jésus n’est pas un personnage historique, il n’a jamais existé. 2) Il n’y a pas de « peuple élu », Dieu n’est pas si exigeant avec la « Loi » et souhaite faire une alliance universelle avec l’Humanité.
Selon Bernard Dubourg, « les rédacteurs néo-testamentaires, en écrivant en hébreu, savent qu’ils travaillent sur la langue sacrée-divine de la Torah ; mais ils savent aussi qu’ils travaillent sur une langue double, à la fois exotérique et ésotérique. Ils la travaillent donc à la fois en clair et dans le cadre de ses modes opératoires traditionnels (kabbalistiques, au sens étymologique du terme) ».
Nous vous invitions à lire les publications de ce chercheur disparu qui, à la manière de tous ceux qui ont fait des recherches sérieuses sur le sujet et sont arrivés aux mêmes conclusions, ont été ostracisés par la communauté scientifique.
Ci-dessous, vous trouverez des passages du troisième chapitre de son livre « L’Invention de Jésus » (Tome 1) qui traite du sens caché du célèbre conte de Perrault : « Le Chat Botté ».
« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de choses cachées. » (Rabbi Nahman de Breslev)

L’énigme d’un marquis
Perrault, on l’a si souvent souligné, prend soin, lorsqu’il introduit tel ou tel personnage, non seulement de le nommer mais même d’expliquer son nom : Cendrillon s’appelle ainsi parce qu’elle « s’alloit mettre au coin de la cheminée, et s’asseoir dans les cendres, ce qui faisoit qu’on l’appeloit communément dans le logis Cucendron ; la cadette qui n’estoit pas si mal- honneste que son aisnée l’appeloit Cendrillon » ; le Petit Poucet, lui, n’est « guère plus grand que le pouce » ; le Petit Chaperon Rouge, dont le surnom semble aller de soi, bénéficie cependant de trois lignes de glose, dans une histoire qui n’en compte pas plus d’une centaine : « cette bonne femme luy fit faire un petit chaperon rouge, qui luy seyoit si bien que par tout on l’appeloit le Petit Chaperon Rouge » ; même explication, aussi peu indispensable à première vue et pourtant bien fournie, pour le méchant Barbe-Bleue : « mais par malheur cet homme avoit la barbe bleue » ; quant à Riquet à la Houppe, il a failli échapper à la règle, ce qui paradoxalement, mais très adroitement, redouble l’intérêt donné par Perrault à son titre : « j’oubliois de dire qu’il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la teste, ce qui fit qu’on le nomma Riquet à la Houppe », avec en prime ce supplément : « car Riquet était le nom de sa famille ». Le Chat Botté et la Belle (au bois dormant), pour leur part, justifient leurs noms ou surnoms au cours du conte même où ils interviennent.
Autrement dit, Perrault, à juste titre réputé pour être un auteur concis, génialement et essentiellement avare de mots et de phrases, paraît en la circonstance perdre des lignes, trop de lignes, à rendre inutilement évidentes des dénominations déjà par elles-mêmes fort claires.
Sur les raisons de cette obstination de Perrault à mettre en défaut sa propre concision lorsqu’il s’agit pour lui de nous présenter un nom, un surnom ou un sobriquet, et de les introduire, je n’insisterai pas : M. Soriano, dans son enquête sur Les Contes de Perrault, culture savante et traditions populaires (Paris, Gallimard, 1968), l’a déjà fait, avec d’ailleurs un grand sens du suspense.
Impasse sur « Carabas »
Par contre, je retiens ceci : une fois, dans Le Chat Botté, il est un nom propre bien obscur, répété comme à plaisir, qui, du fait de son importance narrative, nécessiterait autant que les autres une explication, un nom que pourtant Perrault n’explique nulle part : Carabas. Le chat appelle le cadet « Marquis de Carabas », et la seule justification que l’auteur trouve, d’ailleurs très allusivement, à l’introduction de ce nom, réside dans un brusque accès de fantaisie du matou : « c’estoit le nom qu’il luy prit en gré de donner à son Maistre », phrase qui figure entre parenthèses, comme une politesse nonchalante accordée au lecteur – une incise désinvolte et sans grande importance. Et M. Soriano, pas plus que les exégètes les mieux autorisés de Perrault, ne fait la moindre tentative pour éclairer la signification du surnom du cadet : on ne sait pas ; on n’en parle pas.
Je note d’autre part que les frères Grimm, un peu à la manière desdits exégètes, n’y comprennent rien, eux non plus : ils font, eux aussi, l’impasse sur le terme. Là où Perrault écrivait en vitesse : « Voilà, Sire, un Lapin de Garenne que Monsieur le Marquis de Carabas (c’estoit le nom…) m’a chargé de vous présenter de sa part », ils écrivent, avec un surcroît de lourdeur que Voltaire trouverait germanique : « Quand le chat arriva devant le roi, il fit une profonde révérence, en disant d’une voix forte : – Mon Maître, le Comte de… – et il cita un nom fort long et distingué. » Passons d’un pied agile sur carabas comme vocable prétendument « fort long et distingué », sur la « voix forte » et la « profonde révérence » (les Grimm savent aussi, contrairement à Perrault, que le moulin échu à l’aîné était « à vent »…) :
L’important est que nos recopieurs de Perrault n’ont pas la plus petite idée de ce que veut dire « carabas » ; ils n’y entendent rien.
Perrault ne sait pas, ou fait semblant d’ignorer ; ceux qui le lisent et le copient ne savent pas, ou font semblant de n’avoir pas lu : ils sautent sur la difficulté. Belle unanimité.
Carabas chez Philon
Or la clef de cette énigme, car il y en a une, m’est fournie – aussi invraisemblable que cela puisse paraître –, à plus d’un millénaire et demi de Perrault, par Philon d’Alexandrie, philosophe juif de langue grecque, né en 13 ou 20 av. J.-C., et plus précisément par ce passage de son In Flaccum (« Contre Flaccus ») , passage que je traduis ici aussi littéralement que son grec.
Le grec du passage, et non pas celui de Philon : on verra par la suite les raisons et l’importance de cette distinction.
Et l’élégance me le permettent :
» Il y avait un fou, du nom de Carabas (…). »
Dans cette parenthèse, l’auteur mentionne que la folie de Carabas n’est que bénigne. On insiste, en glosant, sur le fait qu’il s’agit, non d’un fou, mais d’une sorte d’idiot du village. – Souvenons-nous que Jésus-Josué, lui aussi, dans les Évangiles, est un fou ; cf. Marc III, 21 : « À cette nouvelle, les siens [c’est-à-dire sa famille, sa mère Marie-Myryam et ses frères] sortirent se saisir de lui ; car ils disaient : Il est hors de lui ! »
« Celui-ci passait ses journées et ses nuits, nu, sur les chemins, sans redouter d’affronter la chaleur et le froid, souffre-douleur des gosses et des adolescents oisifs. »
« Poussant ensemble le misérable jusqu’au gymnase, et le plaçant tout en haut, pour qu’il soit visible de tous, tout d’abord, aplatissant (?) du papyrus en guise de diadème, ils le lui posent sur la tête ; puis ils lui recouvrent le reste du corps d’un tapis (?) en guise de chlamyde ; et enfin, en guise de sceptre, quelqu’un, voyant un fragment de papyrus du pays délaissé en chemin, le lui tend. Puis quand, comme dans les mimes de théâtre, on lui eut fait endosser les marques de la royauté et les ornements (?) qui sont ceux d’un roi, des jeunes, portant – pareils à des lanciers – des bâtons sur l’épaule, se placèrent des deux côtés, mimant des gardes du corps. Puis d’autres s’avancèrent, certains comme en saluant, d’autres comme bénéficiaires d’arrêts de justice, d’autres comme solliciteurs au sujet des affaires publiques. »
« Puis, de la foule disposée alentour, en cercle, retentit un cri cocasse, le surnom de Marin (ainsi dit-on que se nomme le seigneur chez les Syriens), car ils savaient qu’Agrippa était de race syrienne et qu’il avait une grande partie de la Syrie pour royaume. »
Je suis ici l’édition Pelletier, In Flaccum, Paris, Cerf, 1967, mais non sa traduction.
Carabas et Jésus
La foule, nombreuse, et la victime, unique ; tous contre un, contre le bouc émissaire ; un carnaval ; la pseudo-couronne royale ; la fausse chlamyde ; le faux sceptre ; les faux insignes du faux monarque ; les moqueries de pseudo-courtisans : point n’est besoin d’insister – tout cela redouble à l’évidence les actes et les ustensiles essentiels de la Passion du Christ telle qu’elle se déroule dans les Évangiles. À la simple et naïve lecture de ce passage de l’In Flaccum, on saisit illico que le fou Carabas et Jésus ne font qu’un.
Reprise du problème
Et me revient la question : pourquoi diable Perrault a-t-il donné ce surnom, par chat botté interposé, au cadet des héritiers du meunier ? Car – et ceci est capital – nulle part ailleurs que dans son conte et dans le Contre Flaccus de Philon il n’est question d’un Carabas.
Avec ce maigre correctif cependant : Lucien de Samosate (IIe siècle) mentionne dans deux de ses nouvelles, dont la seconde est peut-être apocryphe, Le Menteur et Les Amours, un certain Corébus, dont la légende grecque rapporte ainsi le vaudeville : « Fou qui, s’étant marié, ne voulut pas coucher avec sa femme par la crainte d’offenser sa belle-mère. Sa femme lui fit accroire qu’elle avait un mal qui ne pouvait se guérir que par l’approche d’un homme, et parvint à lui faire consommer son mariage. » (J’emprunte cette note à la traduction des Œuvres complètes de Lucien par E. Talbot, Paris, Hachette, 1912.) Comme notre souffre-douleur Carabas, ce Corébus est fou, mais là s’arrête leur parenté. En revanche on peut noter entre Carabas et Corébus une simple différence de voyelles ; or l’hébreu – comme le syriaque, l’araméen, etc. – n’écrit que ses consonnes : la racine du mot est donc bien, dans ce cas, KRB ou QRB. – Il y a, comme pour Corébus, une histoire de belle-famille chez Jésus : dans les Talmuds, en effet, on appelle Jésus BR PNDYR’, autrement dit « le fils du beau-père » ; et, dans ces mêmes Talmuds, on le nomme – ou surnomme – également BR STD’, phonétiquement bar Satda : or Satda est une transposition araméenne du grec stadieus, « le coureur du stade » : serait-ce que Jésus aurait été dit fréquenter, et dans les mêmes circonstances, le même gymnase que Carabas le fou ?
J’ai donc demandé à M. Soriano déjà cité, merveilleux connaisseur des Contes et de la vie de leur auteur présumé, si Perrault avait ou non lu Philon d’Alexandrie ; et voici ce qu’il m’a répondu :
« Charles Perrault nous a laissé la liste de ses lectures, soit dans ses Mémoires soit dans ses Hommes illustres, et nulle part, à ma connaissance, il ne cite Philon ni l’Histoire des juifs de Flavius Josèphe. – Toutefois n’oublions pas que sa formation est janséniste et que son frère Nicolas est docteur en théologie. Nicolas a sûrement lu ces auteurs, et, comme les Perrault forment un clan, il me semble vraisemblable que Charles Perrault a bénéficié des lectures de son aîné. C’est évident dans les notices des Hommes illustres que l’académicien a consacrées aux grands théologiens du Siècle de Louis XIV, par exemple Launoy, etc. »
J’en reviens donc, un peu rassuré à présent, à ma question première : qu’en est-il du triangle Carabas-de-Philon/Carabas-de-Perrault/Jésus-des-Evangiles ?
Conscients (qui ne le serait pas ?) de la décisive parenté entre le récit de Philon et celui de la Passion de Jésus, certains érudits ont lu « barabas » au lieu de « carabas » dans l’épisode du gymnase ; on sait que barabas, en araméen transcrit (et approximativement vocalisé), signifie « fils du père » ; on sait également comment Pilate propose à la foule, judéenne cette fois et non pas grecque, d’échanger Jésus (qui se présente constamment, pour sa part, comme fils de son père divin) contre l’émeutier Barabbas, dont plusieurs manuscrits du Selon-Matthieu ajoutent curieusement qu’il s’appelait Jésus : proposition, juridiquement insoutenable au regard du droit romain, d’un échange
Le terme est capital : on le verra plus loin lorsque sera étudié le sens du mot « cocasse » Marin, que la foule fait endosser à Carabas.
Entre deux blancs bonnets ? Hemmerdinger, quant à lui, « montre qu’il s’agit d’un mot grec désignant le possesseur d’un ou plusieurs bateaux », et Pelletier justement accepte cette incroyable conjecture : la Passion du Christ canonique serait- elle celle d’un armateur ? – Car on en revient toujours là : le Carabas de Philon reste, quant au traitement de carnaval qui lui est infligé, le double – le jumeau – de Jésus.
Or nous sommes à Alexandrie, et non à Jérusalem, lors de la mascarade du gymnase ; et la date est clairement fournie par le contexte : la scène se passe durant l’été 38. Durant cet été- là, Caius Caligula, depuis peu empereur de Rome, a transformé du tout au tout la destinée d’un certain Agrippa, celui dont il est question à la fin de l’extrait traduit plus haut, le futur Agrippa Ier, petit-fils d’Hérode le Grand. Or, dans Le Chat Botté également, la destinée du cadet, de misérable qu’elle était, est devenue prospère ; du fait du chat, l’héritier du pire sort est devenu l’héritier du meilleur.
Mais qui est cet Agrippa – qu’en est-il de celui dont la foule grecque se moque, en cet été 38, à travers Carabas ?
Notez, dès lors qu’il s’agit dans les deux cas d’une translittération en grec, la parenté des consonnes (seules écrites en sémite) d’« Agrippa » et de « Carabas » : G et K (ou Q), R et R, P et B.
C’est ici que je m’oblige à une longue digression.
Les tribulations d’Agrippa
Fixer autrement que par un tableau (et encore !) la bonne position généalogique de l’un quelconque des membres de la famille des Hérode relève, on le sait, du funambulisme,
Qu’on lise le schéma fourni dans Flavius Josèphe, Histoire ancienne des Juifs, édition Lidis, Paris, 1973 : c’est un vrai casse-tête. Voir aussi, au livre XVIII des Antiquités, p. 568 de la même édition (dans la traduction d’Arnauld d’Andilly, un Janséniste, le frère du Grand Arnauld, tous deux des amis intimes de Perrault !) : Flavius Josèphe y tente, presque avec succès mais non sans gaucherie, de dire qui était qui et le parent ou l’allié de qui dans cette famille.
Tant les mariages consanguins et les identités de noms sont nombreux et fréquents au sein de cette lignée-là. Malgré tout, Flavius nous apprend qu’Agrippa (14 av.-44 apr. J.-C.) est le fils d’Aristobule, fils lui-même d’Hérode le Grand et de Mariamne I (ou Myryam, Marie), et de Bérénice (Véronique), fille de Costobare et de Salomé (cette Salomé-là étant la sœur même dudit Hérode le Grand).
La Bérénice dont il est question ici n’est pas celle qui fut l’amante passionnée et bafouée de Titus ; et la Salomé dont il s’agit ici n’est pas la supposée fille d’Hérodiade, à propos de laquelle on lit, dans l’Évangile gnostique (?) de Thomas : « Salomé dit : Qui es-tu, homme, et de qui le fils ? Tu as pris place sur mon lit et tu as mangé à ma table. Et Jésus lui dit : Je suis celui… » (paragraphe 61).
Agrippa, pour diverses raisons, passa sa jeunesse à Rome où, nous précise Josèphe, « il fit de si grandes dépenses en festins et en libéralités excessives, principalement en faveur des affranchis de César, dont il voulait gagner l’affection » qu’il se trouva rapidement ruiné.
Autrement dit de Tibère. Dans les Actes de Pilate, version-traduction copte, je vois que Tibère est appelé « Tebelios » et non « Tiberios » ou « Teberios » : or la racine TBL, en hébreu, est celle de l’immersion, du baptême.
Qu’on songe ici, mais je ne puis insister, à la fameuse parabole (en hébreu MŜL – terme et pratique hébraïques et non pas grecques !) du « Fils Prodigue » : la trajectoire de ce fils et celle d’Agrippa ont bien des points communs.
Aussi peu fortuné, donc, que le cadet du conte à ses débuts, Agrippa doit se retirer, en attendant des jours meilleurs, « dans la forteresse de Malatha, en Idumée, pour y passer misérablement sa vie ». Mais ça n’est là que l’infime commencement des tribulations du personnage. Car, alertés par Cypros, sa femme, Hérode le Tétrarque et sa nouvelle épouse, Hérodiade, consentent à lui prêter de l’argent : n’est-il pas, après tout, leur parent ? Libéraux, ils lui octroient en plus la magistrature de Tibériade. Mais les donateurs ne tardent pas à se brouiller avec leur obligé. Agrippa revient donc à la case-zéro. Puis il imagine d’aller trouver Flaccus, le gouverneur de Syrie, pour solliciter son aide au moins financière. Flaccus, tout d’abord bienveillant avec lui à cause d’une amitié qui date de Rome, finit également par se brouiller avec son quémandeur. Deuxième retour d’Agrippa à sa case initiale. Il se retire un temps à Ptolémaïs, l’actuel Saint-Jean-d’Acre (?), puis, dans la plus extrême nécessité, décide de rentrer à Rome. Décision volontaire, cette fois, d’un troisième recul. Par malheur, le pauvre ne possède même pas l’argent du voyage. Le descendant d’Hérode est sans le sou… Alors, pour payer sa traversée, il court trouver un affranchi de sa mère,
Le maître recourt aux services du valet parce que le valet a plus de ressources que lui : ainsi le cadet de Perrault use-t-il des services du chat.
Dont il est d’ailleurs déjà l’insolvable débiteur, et qui ne consent à lui avancer, malicieusement, qu’une partie de la somme requise : Agrippa ne va pouvoir traverser la Méditerranée qu’en partie ! mais va-t-il se noyer dans la case du puits ? Non ; pressé par d’autres créanciers, notre voyageur parvient tout de même à Alexandrie.
Cf., pour les voyages de ce type, et à cette époque, Grand Atlas de l’Histoire mondiale, Paris, Albin Michel-Encyclopaedia Universalis, 1979, carte p. 91.
Connaissant Alexandre, alabarque (magistrat suprême dans une cité hellénistique) de la ville – et frère de Philon, notre auteur –, il le prie de lui prêter ne serait-ce que… 200 000 pièces d’argent, somme énorme qu’Alexandre lui refuse tout en l’accordant à sa femme Cypros déjà nommée (« car, remarque Josèphe, il admirait sa vertu et l’amour qu’elle portait à son mari ») ;
Phrase qui sous-entend qu’Agrippa ne brillait, lui, ni par la vertu ni par l’amour conjugal.
À Agrippa, Alexandre ne consent que… cinq talents (mais ça n’est déjà pas si mal !) ; et c’est ainsi que l’Iduméen réussit à atteindre Rome, tandis que son épouse et ses enfants regagnent la Judée.
Dans Le Chat Botté, le cadet et son valet sont, comme Agrippa, des pérégrinateurs ; ils se déplacent constamment : leur quête, à tous, est géographique.
Une fois en Italie, Agrippa persiste à accumuler les mésaventures et, vaillamment, les emprunts : par exemple : comme le maître perpétuel créancier de son chat, il soutire – c’est énorme ! – 1 000 000 de pièces d’argent à Allus, ancien affranchi d’Auguste. Comme le cadet de Perrault, cet incroyable infortuné, ce gouffre à finances, traîne avec lui le marasme : il tire toujours le mauvais numéro. Pour ajouter encore à ses dettes et embêtements, ne voilà-t-il pas que, lié d’amitié depuis longtemps avec Caligula, fils de Germanicus, il lui confie devant témoins qu’il aimerait le voir tout de suite régner à la place de Tibère ! – paroles qui finissent par parvenir aux oreilles de l’empereur. Et notre héros, très négatif s’il en est, se retrouve aux mains des gardes et jeté en prison.
Le cadet du meunier est au plus bas ; il n’a hérité que d’un chat, alors que ses frères jouissent, eux, du moulin et de l’âne. Symétriquement, l’un des héritiers de Palestine est en prison, criblé de dettes, alors que d’autres, également ses parents, règnent en son pays.
Mais, comme dans le conte de Perrault, il va se produire une inversion des chances et des malchances dans la vie d’Agrippa. Tibère meurt.
Lorsque Tibère meurt, une scène bizarre se produit : quelqu’un annonce la mort de l’empereur à Agrippa, toujours en prison, de cette manière : « Macias ne put se retenir d’aller en hâte donner cette nouvelle à son maître. Il le trouva prêt à se mettre au bain ; et, s’étant approché, il lui dit en hébreu : Le lion est mort. Et Agrippa n’eut pas de peine à le comprendre. » Or, si je ne me trompe, « le lion est mort » c’est en hébreu H’RY MWŢ, ce qui rappelle la pseudo-ville « Arimathie » des Évangiles. En fait, Arimathie y figure à la place de l’hébreu Ĥ’RY MWŢ, litt. « après la mort (de) » – clausule fréquente dans la Bible et qui inaugure, en particulier, le Livre de Josué, autrement dit, via le grec, de Jésus (YHWŜc) : Joseph, soi-disant « d’Arimathie », intervient en [50] réalité « après la mort de » Jésus-Josué ; et la phrase chuchotée par Macias à Agrippa signifie, en filigrane, qu’« après la mort de » Tibère tous les espoirs d’une libération lui sont permis (d’où la saveur de la remarque de Flavius, à présent bien comprise : Agrippa n’eut, en effet, pas de peine à saisir le sous-entendu ; il n’eut pas de peine, notons-le, à le saisir (en l’an 37 ou 38 !) en hébreu).
Caligula accède au trône. Il relâche son ami Agrippa et le fait – revirement on ne peut plus inattendu – tétrarque à la place de tous les roitelets de Palestine : Agrippa porte à présent la couronne.
Pour les circonstances de cette mise en liberté, je renvoie à Philon et à Flavius Josèphe. – Je note d’autre part que la racine PLT (qui figure dans « Pilate ») signifie en hébreu « libérer », « relâcher » – simple remarque en passant (Pilate n’est-il pas celui qui désire relâcher Jésus ?)…
Il n’accède pas tout de suite au trône de Judée ; – qu’on retienne seulement le renversement dans la situation du personnage. Agrippa finira par évincer Hérodiade et son époux, ses créanciers d’antan, qui seront exilés à Lyon. Perrault, lui, ne dit pas que la fortune de l’héritier d’abord mal loti s’est bâtie au détriment de celle de ses deux aînés – la seule éviction du conte est celle de l’ogre, le possesseur, au demeurant, du château.
Et Josèphe a ce commentaire, qui convient parfaitement au cadre du conte de Perrault : « cet événement fut un illustre exemple du pouvoir de la fortune, lorsque l’on comparait les misères passées d’Agrippa avec sa félicité présente ». Le cas de le dire, en effet.
Caligula joue, dans cette affaire, à la fois le rôle du chat et celui du roi, père de la princesse à marier : il est le double instrument de la fortune du pauvre héritier ; grâce à lui – et à lui seul – le pire d’Agrippa est soudain devenu son meilleur.
Mais Carabas, dans tout cela ? – Je ne l’ai nullement oublié ; j’y arrive, ayant atteint l’année 38. Je ne pense qu’à lui.
Agrippa à Alexandrie
Durant l’été 38, Agrippa s’embarque pour rejoindre son royaume. De Putéoles, au lieu de gagner directement la Syrie ou la Palestine, il fait escale à Alexandrie, et cette escale est doublement désavantageuse pour lui. Tout d’abord le gouverneur en est maintenant Flaccus, ce Flaccus avec qui, quelques années plus tôt, il s’était brouillé en Syrie lorsqu’il était son quémandeur ; il le sait ; et c’est sans doute pour cela que Philon note son désir de demeurer à Alexandrie incognito et de ne pas s’y attarder. La ville, d’autre part, peuplée majoritairement de Grecs et minoritairement de Juifs (et de Samaritains), chaque ethnie ayant ses quartiers propres, ses corporations, son statut politique, est présentement le lieu clos d’une lutte ouverte entre les deux communautés, lutte que Philon décrit comme une vraie guerre civile, avec ses exactions, ses pogromes, ses pillages divers. Et, de cette lutte, comme le Pilate des Évangiles, Flaccus se lave les mains ;
La parenté des deux positions et des deux attitudes est frappante (et personne ne la relève !) ; elle l’est plus encore quand on songe, en hébreu, à la parenté graphique des deux noms : PLTWS pour « Pilate », et PLKWS pour « Flaccus » (cf., dans l’alphabet hébreu carré, la forme des lettres kaph et teth).
Il reste passif ; et c’est bien ce que Philon, parce qu’il est juif, lui reproche : car la passivité du gouverneur, loin d’être objectivement neutre, favorise tacitement le clan le plus fort et le plus nombreux, celui des Grecs.
Apprenant qu’Agrippa a débarqué – pour elle, c’est un roi juif – alors qu’en fait il est iduméen, c’est-à-dire, en sémite, ’DMY ou BR ’DM, ou BN ’DM, expression qui signifie aussi, par équivalence graphique entre « Adam » et « Edom » (hébreu ’DM), « fils de l’homme » – que de coïncidences, décidément…
La foule, la populace grecque, au lieu de se moquer de lui ouvertement, de l’attaquer de front, le brocarde par l’intermédiaire et le truchement d’un pauvre substitut : et c’est ici que notre Carabas, le fou, le simplet, fait son entrée remarquée. Et j’en arrive aussitôt au texte de Philon déjà cité et traduit : le fou devenu roi dans une mascarade, la parodie carnavalesque d’une intronisation. Carabas, en réalité, c’est donc Agrippa. C’est d’Agrippa, en fait, que la foule se moque en se moquant de Carabas.
Il est donc facile de comprendre que Carabas ne peut être qu’un Juif : le contexte, l’économie générale de l’anecdote et les remarques linguistiques qui vont suivre, y invitent fortement. Aucune étymologie grecque de « carabas » ne semble d’ailleurs recevable.
Je reviens en arrière. En hébreu le K et le B sont d’une graphie suffisamment proche pour engendrer des confusions : les copistes de la Bible hébraïque nous ont habitués à de telles bévues.
Ils confondent aussi, et encore plus souvent, toujours à cause d’une malencontreuse ressemblance graphique, le R et le D (resh et daleth). Les Septante, en traduisant la Bible en grec, ont parfois encore aggravé ces confusions de lettres.
On saisit donc pourquoi certains ont voulu lire « barabas » à la place de la transcription
« carabas » donnée par Philon.
Et – j’y insiste – cette confusion ne peut s’expliquer qu’en hébreu, en graphie hébraïque, pas en grec !
Remarques de poids sur Philon
Mais il y a plus important. Car, par ailleurs, les exégètes n’ont jamais réussi à prouver que Philon, l’immense commentateur pourtant de la Bible, Juif de race, savait l’hébreu ; il y a même toutes les chances qu’il n’ait jamais su que le grec : ainsi, quand il s’essaie – et il le fait abondamment – à rendre compte par lui-même (hors traditions et recopiage) de l’étymologie de tel ou tel terme hébraïque, son interprétation est le plus souvent inexacte, incroyable ou approximative ; comble du comble pour un Juif, ignorance suprême, il ne connaît même pas, en hébreu, la valeur des quatre lettres de « Yahvé » (YHWH) ! – Le premier réflexe du lecteur du passage sur Carabas dans l’In Flaccum doit donc – devrait donc – être la méfiance : Philon transcrit ainsi un nom propre dont il ne dit pas l’origine étymologique, et même dont on peut être sûr qu’il ne la connaît pas dès lors qu’il s’agit d’un mot typiquement sémite.
À ce compte, il a très bien pu écrire « carabas » là où il aurait fallu écrire « barabas » ; et me voici renvoyé aux Évangiles, au traitement du Christ dans la Passion, à l’échange éventuel Barabbas / Jésus.
Et ce n’est pas tout. Rappelons que Philon est un auteur des plus prolixes : il a écrit des milliers de pages dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles sont grecques de style : Philon est, de notoriété publique, le meilleur des prosateurs grecs-alexandrins. Sa langue ne connaît, fait remarquable dès lors qu’il s’agit d’un écrivain juif.
La dernière édition française de ses œuvres comprend 35 volumes, dont la plupart sont des commentaires sur la Bible (sur des sujets contemporains, il faut compter notre In Flaccum qui fait pendant au Legatio ad Gaium, compte rendu d’une ambassade des Juifs d’Alexandrie auprès de Caligula). – Je dois ajouter, n’en déplaise aux auteurs de manuels, que Philon n’a pas exercé la moindre influence sur la littérature juive-hébraïque postérieure : c’est un érudit juif-grec marginal – par contre, fait significatif, il est lu et utilisé par divers Pères de l’Église.
Flavius Josèphe, son à peu près contemporain, n’est pas dans le même cas que lui ; il sait l’hébreu et l’araméen (il est palestinien) et, si ses livres sont parfaitement rédigés et lisibles en grec, c’est parce qu’il a eu soin de les faire traduire dans cette langue par des experts. Cf. le Prologue de la Guerre des Juifs : « C’est ce qui m’a fait résoudre d’écrire en grec… ce que j’ai ci-devant écrit dans ma langue maternelle, pour en informer les autres nations » ; cf. le Prologue aux Antiquités judaïques : « J’ai sujet de croire que les Grecs prendront plaisir à cet ouvrage, parce qu’ils y verront, traduit de l’hébreu en leur propre langue, quelle était l’antiquité de notre nation » ; et, dans l’Épilogue du même ouvrage, ceci : « Je n’ai pas sujet de regretter le temps que j’ai employé à apprendre la langue grecque quoique je ne la prononce pas avec perfection, ce qui nous est très difficile parce qu’on ne s’y applique pas assez, à cause qu’on n’estime point parmi nous ceux qui apprennent diverses langues » (je laisse ce dernier membre de phrase à l’attention des pseudo- érudits qui en sont encore à se demander si les Juifs de Palestine n’avaient pas majoritairement pour langue maternelle, au premier siècle, le grec : eh non, Flavius le dit explicitement, il était mal vu chez ces Juifs, ses compatriotes, ceux de Palestine, et donc très difficile, avez-vous bien lu, d’apprendre « diverses langues » autres que la sémite ; je dédie également ce passage a ceux qui croient encore en masse que la rédaction originale des Évangiles, globalement sémites dans leur syntaxe et dans leur style, s’est faite en langue grecque).
Ou, plus exactement : par les Septante et autres.
Il y a donc toutes les raisons de penser que Philon n’a eu accès à la Bible qu’au travers de traductions ; Philon, en tout cas, n’a pas eu de rapports avec le texte hébreu : Philon ne savait pas l’hébreu.
La langue originale du passage de Philon sur Carabas
Or, précisément, le passage cité – sur Carabas – jure bizarrement, du point de vue linguistique, avec l’ensemble de l’œuvre : sa syntaxe est telle, dès le premier regard, qu’on peut sans difficulté affirmer : ou bien qu’il s’agit là d’une rédaction grecque par un auteur pensant son texte en hébreu ou en araméen, ou bien qu’il s’agit d’une traduction pure et simple d’un original sémite, grosso modo littérale ; dans les deux cas, on a affaire à une source non grecque, à un modèle primitif sémite.
De cette thèse il faut exclure les deux lignes précisant la nature, bénigne et non pas maligne, de la folie de Carabas et la glose qui, à la fin, tourne autour de la signification du titre Marin, « seigneur ».
HYH ’YŜ KSYL ŜMW… Ainsi devait commencer l’extrait de Philon en hébreu : « Il y avait un (homme) fou du nom de… »
En bref, syntaxiquement parlant, il n’y aurait qu’une difficulté minime à rétrovertir le passage, c’est-à-dire à retrouver son original, que nous n’avons pas, à partir de sa traduction (en grec) que seule nous possédons à présent.
Il reste qu’il est toujours plus commode de rétrovertir syntaxiquement un texte, autrement dit, ici, de faire coller un ordre des mots hébreu sur l’ordre des mots grec, que d’y parvenir sémantiquement : car à un mot grec, ici comme ailleurs, peuvent le plus souvent correspondre plusieurs mots hébreux ; lequel choisir ? Quel était, par exemple, dans l’original, l’équivalent hébreu ou araméen de meménos, « le fou » ? – c’est qu’il existe une bonne dizaine de termes sémites, courants ou non, pour dénoter la folie !
Cette difficulté, dans le cas qui nous occupe, n’est que partielle, et elle peut se contourner, du moins dans une certaine mesure. Voici pourquoi.
Les mots d’emprunt
Les Talmuds – mais plus rarement leur Mishna –, les Targums et les Midrashim, tous textes postbibliques, possèdent entre autres particularités celle de comporter au niveau de leur vocabulaire une foule de mots étrangers empruntés et transcrits tant bien que mal, parfois adroitement, parfois déplorablement, dans l’alphabet hébreu.
Exemple d’une transcription heureuse et immédiatement reconnaissable : ’STRWLWGY’, pour astrologia, « l’astrologie », « l’astronomie » ; le sens et la graphie sont quasi identiques, aux voyelles près, en grec et dans l’emprunt. Exemple d’une transcription cacophonique : DYWZWGY, qui se prononce (?) diyozoughy, est l’équivalent, en emprunt, du mot grec diadokhé, avec le seul sens de « passation des pouvoirs » – pour une meilleure compréhension de ces emprunts et de leurs mécanismes, je renvoie à Jastrow, Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, The Judaica Press, Brooklyn, s.d., et, malgré le tollé ridicule qu’il s’attira lors de sa parution, à l’inévitable Samuel Krauss, Griechische und Lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrash und Targum, réimpression Olms Verlag, Hildesheim, 1964. – Le vocabulaire des Évangiles, et pas seulement des canoniques, et de bien d’autres textes apparentés, gnostiques ou non, des premiers temps du Christianisme, est riche de termes figurant dans le lexique hébreu de l’époque parce qu’ils y ont été empruntés au grec (et au latin : cf. l’Évangile de Marc) et transcrits dans l’alphabet sémite : figurent ainsi, par exemple, les mots qui suivent, tous utilisés dans les Évangiles (et dans le Nouveau Testament en général, tous passages confondus) : argurion, arkhitriklinos, arkhon, apsinthos, basilikos, gazophulakion, gamos, grammateus, diadokhos, diathéké, diakonos, epikourios, epimeleia, episkopos, epistole, sans compter glossokomon (en qui les traducteurs et exégètes n’ont pas honte de voir « la bourse » – et, pourquoi pas ? « le porte- monnaie » de Judas !!!), et d’autres, des dizaines d’autres, rares ou non, hapax ou non ; et ce pullulement prouve, s’il en était besoin (c’est-à-dire : si la preuve syntaxique ne suffisait décidément pas), que la langue originelle des textes fondateurs du Christianisme et de la tradition dont ils témoignent était l’hébreu ou l’araméen ou les deux mêlés : les traducteurs antiques ont ensuite, à chaque fois qu’un mot était commun au grec et, par emprunt, à l’hébreu, choisi ce mot : ils ont, à cette occasion-là, opté pour la solution la plus aisée, la plus commode – la plus littérale. – Ce phénomène est aussi caractéristique, à mon avis, des Évangiles et du corpus néotestamentaire tout entier, que leur syntaxe sémite proprement dite : et personne, jamais, ne l’a vu !
C’est même un des caractères propres de l’hébreu tardif que d’être friand, souvent péjorativement d’ailleurs quant au sens retenu, de tels emprunts au grec (et au latin, au syriaque, etc.). Or, il se trouve justement, comme par un fait exprès, que le passage de Philon sur Carabas, à l’exclusion de tout autre texte (grec, donc) du même auteur, partage cette vive caractéristique, mais cette fois dans l’ordre inverse : il est truffé de mots (grecs) dont l’hébreu tardif (= postbiblique) a, dans son économie propre, fait l’emprunt au grec tout en les transcrivant.
Exemples de mots d’emprunt dans le passage de Philon sur Carabas
Voici quelques exemples, parmi ceux que j’ai su à coup sûr repérer, de ces mots :
Dans l’incise explicative du début, il est dit que Carabas n’est pas un fou furieux mais un simple idiot sans danger pour son entourage. Le traducteur de Philon se heurte là au mot asképtos qui en grec est un hapax.
Hapax : terme n’intervenant qu’une fois dans une littérature, dans une langue données.
Colson, dans sa traduction anglaise, propose de le remplacer
La manie du remplacement chez les érudits et les éditeurs de textes anciens et exotiques mériterait de faire l’objet d’une étude pathologique poussée… par askepastos : dans ce cas, la folie serait « non feinte » ; dans le précédent, elle serait « dangereuse ». Que choisir ? Les traducteurs modernes auraient dû – au lieu de se laisser tenter par un trafiquage du texte – faire appel à l’hébreu tardif, car dans cette langue-là il existe en effet un emprunt au grec, ’SQPSTY, transcription qui ne recouvre que le mot skepastos,
Le aleph de la transcription de ce mot n’est nullement un a privatif : il s’agit d’un effet phonique ; cf. la différence entre le français station et l’espagnol estación ; les Juifs transcrivent le grec, lorsqu’il commence par une consonne qui s’y prête, comme les Espagnols le feraient : ils adjoignent au début du mot une fausse voyelle et, dans la prononciation, un i, un o ou un é (cf. aussi la préface du dictionnaire de Jastrow, qui fournit une explication mieux développée de ce phénomène).
Dès lors, dans l’incise de Philon, askepastos n’est pas du tout un hapax ; il est là pour figurer l’emprunt ’SQPSTY au grec skepastos, avec le seul sens d’« abrité », « couvert », « recouvert ». La phrase ne signifie donc nullement « la folie furieuse est dangereuse pour ceux qui en sont atteints et pour ceux qui les approchent », comme le croient Pelletier et Colson, ni « ceux qui en sont atteints et ceux qui les approchent ne peuvent que la constater », comme le croient Cohn et Reiter, mais bien, via l’hébreu : la folie furieuse est une protection, un abri, dont bénéficient ceux qui en sont partiellement ou totalement atteints ; les fous furieux, en somme, on ne saurait les traiter comme le pauvre Carabas : car verrait-on ainsi, en plein milieu du Carnaval, le faux roi pris de transes démoniaques, irrésistibles, et sautant à la gorge des assistants ?
Mais venons-en maintenant aux acteurs du drame. Le souffre-douleur est pris à partie par des enfants, des adolescents oisifs, sans occupation, en grec skholazonton ; et il est fou : en araméen SKL’, prononcé sakla, signifie « fou », et ’SKWL’, prononcé iskoly, est un calque non pas de l’oisiveté, mais de l’école, en grec skholé : les jeunes gens dont parle ici Philon sont des scolaires, des étudiants – on ne pourrait d’ailleurs autrement comprendre la minutie et l’intelligence, le raffinement, du rite de carnaval auquel ils soumettent le simple d’esprit ; ce ne peut être un ramassis de gamins illettrés ! Ici l’hébreu nous aide à rétablir, sous le grec, le sens (originel) du passage, et non pas seulement à l’illustrer.
Cf. aussi, par exemple, l’hébreu KSYL, anagramme de ce mot et porteur du même sens. Tout rédacteur sémite est gourmand d’user d’anagrammes : sa langue lui permet ces jeux ; on dirait même qu’elle l’y invite, l’y force (ce qui n’est en rien le cas du grec et, plus généralement, des langues indo- européennes).
L’ayant poussé au gymnase, les jeunes mettent Carabas bien en vue de l’assistance, et ils lui octroient une fausse couronne. Puis, dit Philon, en guise de chlamyde ils lui couvrent le reste du corps d’un tapis.
C’est là que sont les écoles, dans le monde gréco-romain. Chlamyde et tapis sont deux mots que l’hébreu tardif connaît pour les avoir volés au grec. Khlamus, « la chlamyde », y est transcrit KLMWS, prononcé klamos, et désigne alors le vêtement de l’officier, par opposition à l’emprunt SGWN (grec sagos, latin sagus ou sagum) qui désigne, lui, la tenue du simple soldat.
Quant à khamaïstrotos, que Pelletier traduit par « le tapis », ce n’est en grec qu’un adjectif, d’ailleurs rarissime, et non un substantif, signifiant « étendu par terre » ; ce terme, injustifiable ici en grec, ne peut se comprendre que par recours à l’hébreu : sa transcription y figure, en effet, sous la forme ĤYMWŞŢ’ et y désigne, en tant que substantif, l’habit pourpre des grands personnages romains, l’habit de parade des puissants du paganisme. Comme au cours de la Passion le Christ, on a revêtu Carabas non pas d’un adjectif, et non pas d’un tapis – n’en déplaise à Pelletier et à son aversion de l ‘hébreu –, mais d’une toge pourpre.
Je passe sur papuros, « le papyrus », qui, emprunté par l’hébreu tardif, devient PPYYR (prononcé papyar) et y signifie alors : « le papyrus » (la plante), mais aussi « le tissu fait de papyrus ». Le diadème mis sur la tête du fou était donc bien en tissu végétal.
La « couronne d’épines » de Jésus (si la rétroversion vers l’hébreu originel permet de conserver cet ustensile) est également végétale.
Le rite se déroule comme au théâtre dans les mimes : os en theatrikoïs mimoïs. Là encore deux termes figurent dans le vocabulaire emprunté par l’hébreu au grec. L’un est MWMWS (prononcé momos ou moumos) et désigne le mime ou l’acteur de mime. L’autre est beaucoup plus intéressant pour notre sujet : « le théâtre », theatron, produit, en transcription hébraïque, plus d’une douzaine d’approximations graphiques et phonétiques: ’STRY’, ’STRYH, ’STRYY’, ’YSTRY’, ’ŞTRY’, . ’YŞTRY’, etc. ; tous ces mots désignent le théâtre, mais aussi plus généralement l’arène, le gymnase, les combats de gladiateurs, les courses, le cirque, l’amphithéâtre, et, à chaque occasion, péjorativement eu égard à la tradition et à l’idéologie juives strictes, l’ensemble des spectacles et des rites païens : au point que ’ŞTRY’ finit par vouloir dire « lieu de débauches », « lupanar » ; on trouve dans la littérature juive de l’époque des phrases comme celle-ci (Tosephta Avoda Zara Il, 7) : « Quiconque fréquente le théâtre (’STRYN) est un meurtrier. »
D’autre part, curieusement, la transcription du mot theatron, ’STRY’ (« le théâtre », etc.), et celle du mot stratia (« l’armée »), sont, à une lettre près, les mêmes : et c’est d’ailleurs pour cela que, dans la phrase que je viens de citer, on assimile les spectateurs des cirques à des assassins, à des soldats romains – honnis. C’est par ces mots aussi, par cette parenté de mots, que s’opère la jonction Jésus/Carabas : l’un est maltraité par des soldats, l’autre par des théâtreux – même écho phonétique, et idéologique, à l’oreille d’un Juif s’exprimant en hébreu : aucune espèce de soupçon de rapport dans le grec.
En Matthieu XXVII, 27 (mais cf. les parallèles en Marc et Jean), on lit ceci :
« Alors les soldats (oi stratiotaï) du gouverneur (tou égemonos) reçurent Jésus dans le prétoire (to praitorion)…» Or, « soldat », « gouverneur » et « prétoire » (sic !) sont des mots que l’hébreu tardif emprunte au grec : ’STRTYWT, pour stratiotés, « le soldat », « l’officier romain », « le messager » (notez, ici comme ailleurs, le glissement sémantique qui s’opère entre le vocable originel et l’emprunt hébraïque !) ; HGMWN, pour égemon, « le général » (mot qui assone parfaitement avec l’hébreu ’GMWN, « le roseau », alors que cette assonance n’existe pas en grec – d’où la valeur narrative de la canne de roseau qu’on donne à Jésus pour se moquer de lui; avec ’RGMWN, « le vêtement de pourpre », alors que cette assonance, de nouveau, n’existe pas dans le grec – d’où la robe dont on l’affuble ; ainsi qu’avec le verbe ’RG, qui signifie « tresser », assonance absente du grec – d’où le tressement de la couronne d’épines) ; enfin PLTRYN, PLTYRYN OU PLTWRYN, avec, dans tous les cas, un L et non un R, pour praitorion, « le quartier général », « le palais », « la résidence ou le siège régional du gouverneur païen » – et non pas « le prétoire » ! (mot qui assone, par exemple, avec PLTWS ou PYLTWS, « Pilate », d’où l’importance narrative de ce personnage au cours de la Passion évangélique), – D’où il suit que le texte concernant le traitement carnavalesque de Jésus dans les Évangiles répond aux mêmes caractéristiques syntaxiques et sémantiques (ordre sémite des mots, termes d’emprunt) que le passage de Philon sur Cacabas.
Intéressante convergence. Convergence que, depuis vingt siècles, personne n’a remarquée – ou voulu remarquer !
Intervention du Livre d’Esther
Je note également – mais ceci devrait faire l’objet d’une étude spéciale – que le livre par excellence où, dans la Bible, il est question d’une pendaison, d’une suspension au bois, autrement dit, pour la tradition à venir, d’une crucifixion, est le Livre d’Esther.
Il n’y a pas de mot hébreu-biblique pour désigner la croix ; on dit tout simplement le bois (ou l’arbre, cŞ, comme celui du Bien et du Mal…) : c’est le mot utilisé par les Évangiles, en grec stauros. Cette impossibilité à varier les termes n’est pas grecque ou latine, elle est hébraïque : elle est normale pour un sémite. Et la question demeure alors : crucifixion ou pendaison ? – Mais cette pauvreté sémantique ne vaut que pour l’hébreu biblique ; en hébreu tardif, il en va quelque peu différemment. Outre ŞLB, « la croix », l’hébreu des Talmuds possède des termes d’emprunt, ainsi par exemple ’LKSWN, calqué sur le grec loxos, « diagonal », « oblique », d’où « louche », « ambigu », et qui signifie, comme adverbe, « en croix », « en diagonale », et, comme substantif, « la diagonale », « le diamètre » (terme utilisé dans ce sens dans le Sepher Yetsira). Or, par hasard, il se trouve que ce mot, graphiquement et phonétiquement, assone presque entièrement avec ’LKSNDRWS, ’LKSNDRY et ’LKSNDRY’, autrement dit avec « Alexandre », « alexandrin » et « Alexandrie », de sorte que ’KSNDRY’ en vient à signifier à la fois « un commerçant d’Alexandrie » et, avec humour ou mépris, « une croix », « un haut-mât », « une potence » : et c’est ce mot, prononcé aksanddrya, qui figure en toutes lettres dans la phrase suivante (Targ. II sur Erther VII, 10) : « Le fils d’Hamdatha (i.e. Aman, ici identifié à Pilate!) veut monter au mât le fils de Pandira (i.e. Jésus). » Pas étonnant, dans ces conditions, que Jésus soit crucifié cependant que son double, Cacabas, sert de jouet à des Alexandrins : le vocabulaire implique, un jour ou l’autre, pour peu qu’il soit hébreu tardif (et c’est celui-là même qui nous occupe), qu’un crucifié, dès que du commentaire s’y mêle, a quelque chose à voir avec Alexandrie. Or, tout familier des narrations et des commentaires talmudiques sait que c’est à des jeux de récits de ce type que mène l’économie de la langue hébraïque – l’économie de la langue : pas l’histoire !
On sait, en outre, que le Livre d’Esther est à l’origine de la fête juive des Pourim, c’est-à-dire des Sorts, autrement dit du Carnaval des Juifs. À mon avis, le squelette des Évangiles originaux – comme récits, non comme recueils de paraboles – est emprunté à ce livre.
Aman, qui a voulu crucifier (pendre?) le Juif Mardochée, se retrouve finalement suspendu au bois avec ses enfants.
Toujours cet effet d’inversion, la grande tradition, en effet, des carnavals, des bizutages, des rituels de compensation ; et, dans le réel cette fois, le brusque retournement du destin d’Agrippa, retournement brocardé, ridiculisé, par la foule des Grecs d’Alexandrie : le renversement du renversement.
Or « Esther » se dit en hébreu ’ŞŢR, mot qui a une parenté immédiate avec celui qui désigne, par voie d’emprunt et tardivement, le théâtre et la soldatesque : on comprend que Jésus soit crucifié par les soldats et que Carabas, de plus en plus son double, soit mis à mal dans un amphithéâtre. Tout cela concorde parfaitement et s’adapte avec Joie.
Toujours cette cellule STR/SŢR comme pivot : c’est la racine d’Esther, la racine qui sert de papier-calque lors de l’emprunt hébraïque des mots grecs stratia, stratégos, stratiotés, « la soldatesque », et c’est la racine du mot theatron, « le théâtre », lorsqu’i1 est emprunté, et c’est, pour couronner le tout, la racine du bois, de la croix, de Jésus-Josué : stauros, dans les Évangiles ! Quelle cascade de coïncidences…
Concorde et s’adapte en hébreu : pas en grec.
Encore des mots d’emprunt
Mais je continue l’examen des emprunts. On remet à Carabas les insignes, les insignes distinctifs, de la royauté (grec paraséma). Il existe un mot hébreu, non emprunté (?) cette fois, qui assone illico avec le mot grec utilisé ici: PRSM, terme qui désigne la divulgation, l’exposition, la mise en public, la publication : l’hébreu et le grec sont d’accord, par hasard (?), sans emprunt (?), sur la graphie et sur le sens.
On donne ensuite à Carabas les ornements (?) propres au roi; Pelletier traduit: « quand il fut attifé en roi », kai diekekosmeto eis basilea. Or diakosmein n’est jamais attesté dans la [65] littérature grecque avec ce sens-là : il y signifie seulement « mettre en ordre un cortège » (alors qu’il s’agit ici d’un individu), « organiser », « régler », « prendre soin de ». Là encore, seul le passage par l’hébreu peut et doit nous renseigner : QWZMYN, transcription de kosmos (qui donne, en français, « cosmétique »), veut dire, en tant que terme d’emprunt, « la joaillerie », « les bijoux », « les ornements de la parure », et, plus proche cacophoniquement du terme grec employé ici, QWZMYDY’, pour kosmidia, porte le même sens. Autrement dit, l’auteur (le traducteur?) a utilisé ici un terme grec non point dans son sens grec mais dans celui qu’il avait pour les Juifs hébraïsants l’ayant transcrit dans leur langue et dans leur système graphique.
Les jeunes gens se placent de chaque côté de Carabas et lui font la haie ; ils jouent les lanciers et les gardes du corps: anti logkhophoron… mimoumenoi doruphorous. LWNKY, pour le grec logkhë, « la lance », « l’épieu », « le javelot », est un terme d’emprunt en hébreu tardif.
C’est cette lance-là qui figure en Matthieu XXVII, 49 et en Jean XIX, 34 (logkhé dans les deux cas) : encore un parallèle entre la Passion de Jésus et celle de Carabas.
Quant aux porteurs de lances, ce sont des LWPRYN , mot cacophoniquement calqué, avec abréviation, sur logkhophoroï pour désigner en effet « les porteurs de piques » (bouviers, ou soldats en armes). Emprunt similaire pour doruphoroï « les gardes du corps », avec le calque approximatif DRBWNYN, même sens que le grec.
Conséquences
Voilà donc, très rapidement rapportées, quelques caractéristiques du vocabulaire du texte de Philon concernant Carabas. Je note que beaucoup de termes, anormalement nombreux ici, y sont des mots figurant dans le vocabulaire tardif de l’hébreu des Talmuds, des Targums et des Midrashim (et de leur araméen) à titre de transcriptions à partir du grec. Et cette constatation objective m’amène tout naturellement à l’hypothèse suivante : l’anecdote concernant Carabas n’est nullement d’origine grecque ; sa source est linguistiquement sémite, hébraïque ou araméenne. Dès lors, ou bien Philon a utilisé cette source et l’a traduite lui- même en grec, assez littéralement d’ailleurs pour que se trahisse le point de départ (vocabulaire et syntaxe) de cette traduction – mais comment imaginer que cet auteur, ignorant, comme nous l’avons dit, les langues sémites, ait pu procéder en personne à un tel travail ? –, ou bien alors, thèse beaucoup plus probable, la source sémite a été traduite en grec et insérée après coup dans le cours du livre de Philon : mais, dans ce cas, il faut réinterroger la chronologie de ce récit : est-ce bien en 38, à Alexandrie, à l’occasion du passage d’Agrippa dans cette ville, qu’un simple d’esprit ou prétendu tel s’est fait maltraiter par une populace ?
Cette question prend tout son poids dès qu’on remarque ceci : les jeunes gens qui persécutent Carabas sont des jeunes Grecs ; sans cela la scène n’a plus la moindre vraisemblance. Il est fort peu probable que ces jeunes gens connaissent les langues sémites.
Les Juifs d’Alexandrie eux-mêmes sont réputés ne plus savoir parler, lire et écrire l’hébreu.
Or, la foule présente au spectacle prononce bel et bien un mot sémite: « Puis de la foule disposée alentour, en cercle, retentit un cri cocasse, le surnom de Marin – ainsi dit-on que se nomme le seigneur chez les Syriens –, car ils savaient qu’Agrippa… » La foule qui prononce un mot sémite serait-elle donc juive ? Seraient-ce les Juifs d’Alexandrie qui se moquent du roi iduméen de Palestine ? Car, je le répète, on ne saurait dire que la foule prononçant un tel mot soit bien grecque : les Grecs d’Alexandrie n’ont certainement jamais su, en foule, que Mar veut dire « seigneur », « maître », en sémite !
Grec atopos, « cocasse », « absurde », « étrange » – pour Philon, l’araméen et l’hébreu sonnent donc comme des barbarismes!…
Ainsi, j’ai toutes les peines à croire : ou bien que Carabas a été maltraité par des Grecs ; ou bien, ce qui est plus grave, qu’il ait été maltraité par des Alexandrins, juifs ou grecs. – La fin du passage est d’ailleurs des plus embrouillées : le rédacteur, ou plutôt le traducteur grécisant, se doit d’expliquer le terme de Marin (terme sémite, non grec – et dont la translittération paraît, en plus, fautive) comme s’il ne comprenait pas lui-même sa signification : on dit qu’en Syrie c’est ainsi qu’on appelle… S’il s’adresse à des Alexandrins, et plus précisément aux Grecs de cette ville, c’est donc qu’il explique à la foule ayant prononcé le mot le sens même du mot qu’ elle a prononcé : c’est absurde. Si, par contre, il s’adresse aux Juifs, c’est qu’il les considère comme ignorant leur propre langue : dans les deux cas nous aboutissons, eu égard à l’origine araméenne ou hébraïque du passage, à une impasse pure et simple.
MR (prononcé mar) signifie en hébreu « le seigneur », « le maître ». Le féminin du mot est MRŢ’ (martha) en araméen, « la maîtresse ». Mais MR signifie aussi « l’échange », « la substitution » : B-MR D veut alors dire « à la place de », « en guise de » – en guise du roi Agrippa, on se moque de Carabas ; en guise de Barabbas, on suspend ou crucifie Jésus après l’avoir maltraité ; et, chez Perrault, le chat fait jouer à Son cadet de maître le rôle, factice, du propriétaire et du pseudo-noyé. Et puis MR veut dire « l’aigre »,
« l’amer » : on se souvient du fiel ou du vinaigre, tendu à Jésus sur la croix. Et MR’H signifie « l’apparence », « le (faux-)semblant » : les docètes, idéologues des premiers temps du Christianisme, pensaient que Jésus n’était que faussement mort sur le bois ; on l’avait, selon eux, subrepticement remplacé au dernier moment (par Simon de Cyrène, par exemple). – Et, puisque MR désigne « l’échange », « la substitution », j’ajoute ceci, qui peut en un sens expliquer l’origine et la portée de l’échange entre Barabbas/Carabas et Jésus : presque à chacune de leurs apparitions dans la Bible hébraïque, plusieurs fois dans le Premier Livre des Rois (VI, 29, 32 et 35, ainsi que VII, 36) et dans le Livre d’Ézéchiel (XLI, 18, 20 et 25), les Chérubins (même racine que « Carabas ») sont associés aux palmiers ; or
« palmier » se dit en hébreu ŢMRH, mot qui, associé à la racine MR, signifie également « l’échange » : de sorte que le WŢMRH BYN-KRWB LKRWB d’Ézéchiel XLI, 18 se lit aussi bien « un palmier entre deux Chérubins » que
« un échange entre deux Chérubins » (ou, plus exactement, « entre KRwB et KRwB »).
Résultats de l’enquête sur Carabas
Je résume à présent les résultats obtenus : nous avons Le Chat Botté qui, comme la plupart des autres contes de Perrault, décrit la brusque et progressive revanche d’un mal-loti sur son destin ; – et nous avons la vie d’Agrippa Ier, trajectoire allant, elle aussi, du pire au meilleur; – et puis, comme dans un reflet symétrique-inversé de ces deux récits, nous avons Jésus et Carabas, moqués tous deux, l’un à la place des hommes et pour leur rachat (?), l’autre à la place d’un roi. Puis, comme réciproquement, nous avons le chat qui prend à tout instant la place de son maître : c’est lui le besogneux, le rusé, l’actif : l’acteur ; c’est lui qui décide de tout et mène tout, gestes et paroles, à son bon terme. De même, si Agrippa retrouve son royaume après tant de déboires, c’est grâce à la seule aide de Caligula : sans son providentiel ami l’empereur, il ne serait rien qu’un endetté, un prisonnier, un errant; sans lui, jamais il n’aurait évincé ses concurrents roitelets de Palestine: sans lui, jamais il ne se serait mis à leur place ; Caligula est le chat d’Agrippa.
Et Perrault joue de toutes ces allusions en leur procurant un rendement maximal. Car je rappelle, pour corser les jeux de mots, que « caligula » est un sobriquet conféré à Gaius par les soldats, sobriquet qui signifie « la sandalette », « la bottine » : Caligula n’est donc pas que le chat d’Agrippa, il est son chat botté!
Et enfin, linguistiquement, le mécanisme de substitution est le même : à la place du texte original, sémite, décrivant le pauvre sort du pauvre Carabas et son calvaire de Carnaval, nous ne possédons plus qu’une narration grecque qui, dans sa syntaxe comme dans son vocabulaire, ose à peine s’affirmer comme telle, au milieu d’un livre où elle ne figure plus, sans doute, que comme un objet rapporté : un ersatz. Les pièces du dossier, qui n’étaient au départ que de bric et de broc (Jésus-Barabbas, Perrault-Carabas, Philon-Carabas, Carabas-Agrippa, Carabas-Barabbas), s’assemblent maintenant comme en un puzzle, et l’on peut dès lors être assuré que Perrault, soit par ses propres lectures, soit par des informations recueillies auprès de son frère le théologue ou de ses amis jansénistes, en connaissait mieux la vraie et authentique clef qu’on ne l’a jusqu’ici soupçonné.
On peut et doit en dire autant des Évangiles, textes versés littéralement du sémite dans l’indo-européen.
Et, à la courtoise et attentionnée lettre de M. Soriano, je réponds donc, aussi cordialement qu’il convient, que Charles avait été, pour sûr, bien renseigné par Nicolas.
APPENDICE À CARABAS
J’ai, tout au long de cette étude, assez fortement insisté sur le fait que la plupart des termes clefs figurant dans la narration de Philon sur Carabas et dans les parallèles de Matthieu, Marc et Jean, figurent également en bonne place dans le vocabulaire des Talmuds (Mishna et Gémara), des Targums et des Midrashim comme emprunts explicites au grec (et au latin via le grec). Pour préciser encore (à l’usage des exégètes aveugles – depuis vingt siècles), je fournis ici la liste de ces termes, en examinant un à un les textes en question
Philon, In Flaccum, parag. 37 à39.
1/ anti,
Je donne, dans cette liste, les mots grecs sous la forme, aux personnes et aux temps, qu’ils ont dans les textes considérés au moment où ils y interviennent (sans, d’autre part, la moindre considération pour les accents et les esprits).
« en guise de », figure comme préfixe en hébreu d’emprunt sous la forme ’NTY.
té kephalé, « la tête », y figure sous les formes QPLWT, « le poireau à tête (porrum capitatum) » et QPLTYN, « la perruque », « le couvre-tête ».
khamaïstroto, « étendu par terre », impossible ici comme adjectif, est bien un substantif lorsque l’hébreu tardif l’emprunte sous la forme ĤYMWŞŢ’,
Peut-être paraîtra-t-il difficile au spécialiste de croire que ce terme peut être emprunté par l’hébreu tardif comme un calque du grec khamaïstrotos ; par contre, la coïncidence graphique et phonique entre les deux mots est frappante et incontestable – sans compter que le sens de ĤYMWŞŢ’, « le vêtement de pourpre que porte l’officier païen », convient ici tout à fait au sens (substantif et non adjectif) et qu’il s’accorde, de plus, avec les narrations évangéliques.
« le vêtement de pourpre », « la tenue écarlate de l’officier ». 4/ khlamudos, « la chlamyde », devient
Par « devient », j’entends : …devient lorsque l’hébreu tardif l’emprunte et l’introduit dans le moule de son alphabet propre. – Ce « devient » pose un grave problème au niveau du corpus néotestamentaire : car comment doit- on y traduire les termes d’emprunt qui y fourmillent – en ne recourant qu’au lexique grec (comme le font depuis des siècles, et encore aujourd’hui, tous les spécialistes), ou bien en recourant au lexique hébreu dérivé ? Grave problème, en effet, puisque les termes empruntés, ainsi qu’on le voit dans le catalogue que je dresse ici, sont souvent inadéquats au sens qu’ils ont, qu’ils avaient, en grec pur ; en passant du grec à l’hébreu, ils perdent souvent certaines de leurs acceptions premières, ils en gagnent d’autres, etc. Comment se fait-il que de tout cela les traducteurs européens du Nouveau Testament – et les Églises – ne tiennent jamais compte ?
KLYNDYN, « le manteau d’apparat », ou, plus littéralement, KLMWS, « la chlamyde », « la tenue pourpre de l’officier ».
5 / papurou, « le papyrus », devient PPYYR, « le papyrus », mais aussi : « le tissu de papyrus », « la texture du papyrus ».
Bublos, également employé par Philon, n’est pas, du moins à ma connaissance, emprunté par l’hébreu tardif.
6/ tés egkhoriou, « le pays », n’est pas emprunté tel quel, mais khorion, de même famille, l’est sous les formes PR’KWRYN (= parakhorion), « le district », et PRYKWRYN (= perikhorion), « le territoire », « le voisinage ».
7 / theatrikoïs, autrement dit theatron, « le théâtre », devient – j’en ai longuement fait état – ’STRY’, ou encore ŢY’TRWN, ainsi qu’une dizaine d’autres graphies, toutes signifiant « le théâtre », « l’amphithéâtre », « le cirque », « les jeux du cirque », « les spectacles et les lieux de spectacles païens », « la débauche »,
Autres graphies qui vont des plus littérales aux plus cacophoniques. Le fait que les emprunts de l’hébreu tardif (postbiblique) au grec passent par toutes sortes de cacophonies, dues et à l’éloignement des deux alphabets et au génie phonique et graphique de chacune des deux langues, renforce la parenté, dont j’ai parlé plus haut, entre ’STRY’, « le théâtre », et ’STRTY’, « la soldatesque », et renforce du même coup, bien au-delà de la considération, dès lors nécessairement superficielle, du grec, la similitude déjà frappante de soi entre le récit de Philon sur Cacabas et ceux de Matthieu, de Marc et de Jean, sur les moqueries dont on accable Jésus-Josué.
La débauche est un thème courant dans les apocryphes du Nouveau Testament. Ainsi, par exemple, dans les Actes de Pilate (version copte), les Juifs affirment à plusieurs reprises que Jésus « a été enfanté dans la débauche (hn oupornia) » – cf. Graffin et Nau, éd., Patrologia Orientalis, t. IX, fasc. 2, dans les Évangiles, l’épisode dit « de la femme adultère ») – cf. aussi le lieu de naissance « davidique » (?) de Jésus-Josué, Bethléem, c’est-à-dire BYŢ- LĤM, litt. « la maison du pain » : et justement, dans les Actes de Pilate déjà cités, on mêle les informations, rapprochement narratif qui n’a aucun sens, aucun fondement, en copte ou en grec, mais qui en détient un, et très clair, lorsqu’on se réfère (par rétroversion) à l’hébreu sous-jacent, d’emprunt ou non. Car ainsi court le texte : « Nous savons que tu as été enfanté dans la débauche ; secondement, nous savons que ta naissance a eu lieu à Bethléem et qu’à cette occasion on a tué cette grande foule d’enfants » (et, là encore, intervient un jeu de mots inintelligible en dehors du recours à l’hébreu, LĤM y signifiant en effet, dans la Bible comme ailleurs, « le pain » et « le massacre »). – J’ajoute, mais il faudrait là une étude spéciale qui n’a jamais été menée, que, tout autant que le Nouveau Testament dit « canonique », les apocryphes (sic) coptes fourmillent de mots non pas égyptiens mais proprement grecs, mots qui figurent à foison parmi le lexique des termes empruntés au grec (et au latin via le grec) par l’hébreu tardif – sans parler de tous les mots hébreux, non étudiés jusqu’à ce jour pour eux-mêmes, qu’on rencontre à l’état de pures et simples transcriptions dans les textes gnostiques et apparentés.
« Les Apocryphes Coptes II », Paris, rééd. 1957, p. 76 s. E. Revillout traduit pornia par « le libetrinage », belle litote car porné signifie, en grec autant que comme emprunt dans l’hébreu tardif, « la putain », « l’adultère » : la graphie en est alors PWRNY, forme qui recouvre d’ailleurs également un emprunt au latin furnus et au grec phournos, « le four à pain » : comprendrait-on alors pourquoi il est tant question de pain dans le Nouveau Testament ? (cf. aussi, « les lieux de débauche ».
8/ mimoïs, « les mimes », devient MYMWS ou MWMWS, « le mime » ou « l’acteur de mime ».
Curieusement, il y aurait donc une très bonne assonance, invisible en grec, entre le « comme pour les mimes » de Philon et la « chlamyde » et de Philon et des évangélistes, soit d’une part KLMWMWS et de l’autre KLMWS (pour l’assonance entre le roseau et la chlamyde, encore invisible en grec.
9/ paraséma, « le signe extérieur », « le signe (de la royauté) », sans être, pour autant que je sache, emprunté par l’hébreu, assone pleinement avec PRSM, « divulguer », « rendre ostensible », « rendre public ».
10/ basileias comme basileus, « le roi », figurent en hébreu d’emprunt sous les formes BSYLY’WS ou BSYLYWS, même sens,
11/ diekekosméto, « arranger », « mettre en cortège », incompréhensible ici par et dans le grec, correspond en fait à l’hébreu d’emprunt QWZMYN, « les bijoux », « la joaillerie », « la parure de bijoux » : on couvre Carabas de bijoux de toc pour lui imposer l’allure et l’apparat d’un roi factice.
La similitude de graphies entre kosmos/« le monde » (devenu dans l’hébreu d’emprunt l’un des composants, par exemple, de QWZMWQRTWR, grec kosmokratôr, ou de QWZMYQWN, grec kosmikos – termes, soit dit en passant, évidemment présents dans le Nouveau Testament) et kosmos « la parure » (devenu par emprunt QWZMYN) a très judicieusement été mise à profit par les traducteurs soucieux de puiser à plein dans le lexique hébreu d’emprunt ; c’est ainsi, pour ne donner qu’une seule illustration de cette astuce, qu’on lit au paragraphe 110 de l’Évangile (copte pour ce qui nous en reste, à part quelques fragments en grec) de Thomas : « Quiconque a trouvé le bijou (kosmos) et est devenu riche, qu’il refuse le monde (kosmos) ! » – mais, dans The Gospel according to Thomas, Leyde, Brill, 1976, les éditeurs et traducteurs anglais se font piéger et rendent les deux kosmos du passage par « le monde (the world) », ruinant ainsi le jeu de mots qu’ils ne voient pas faute de s’en référer aux particularités des emprunts de l’hébreu tardif (notons que ces mêmes éditeurs et traducteurs croient cet évangile originellement rédigé en grec, « avec des sémitismes » – on voit, tristement, où les conduit leur croyance !).
12/ logkhophoron, « les lanciers », devient, grâce à un joli raccourci, LWPR (ou LYPWR),
« le garde du corps » (cf, aussi LWNKY, pour le grec logkhé, « la lance », également un terme emprunté).
13/ doruphorous, « les gardes en armes » (voir le français « doryphore »), a pour pendant, cocassement emprunté, DRBN’H, même sens.
14/ dikasomenoï, « se faire rendre la justice », « plaider », produit l’emprunt DYQY (= grec
diké, « la justice »), « le droit », « le châtiment », « la juste satisfaction ».
15/ koinon, « commun », produit l’emprunt QYNWNY’ (= grec koïnonia), « la communauté d’intérêts », « la complicité », « la connivence »,
Les lecteurs ayant une familiarité même moyenne avec le lexique du Nouveau Testament feront ici, tout du long, les rapprochements qui s’imposent; tout le corpus chrétien, sans que la moindre page [75] y fasse exception, exhibe aux yeux de qui veut bien les voir – autrement dit : de qui sait lire sous le grec – des dizaines et des dizaines de mots d’emprunt (au sens où je l’entends ici) : et les exégètes et les traducteurs modernes n’y voient que du feu ! – Or, comme je l’ai souligné plus haut, et comme on le constate en parcourant mon catalogue, souvenons-nous que tous ces mots portent en eux, à distance du lexique grec-pur dont ils sont originaires, le risque d’un glissement de sens parfois considérable.
16/ pragmaton, « les affaires », devient par emprunt PRGMT’, sens équivalent.
17/ J’élimine évidemment, dans le passage de Philon, Marin, « seigneur », qui est un mot sémite (d’ailleurs mal translittéré), et passe à apokalounton, « appeler », « nommer », qui correspond à l’hébreu d’emprunt QLWN, « je proclame » (voire à KLY, qui est, lui, un verbe sémite pur voulant dire « appeler », « rassembler », « produire un signal » : dans ce cas, nous avons comme par hasard une assonance entre le grec et l’hébreu).
18/ kurion, « le seigneur », devient QYRWS, même sens.
19/ para, « chez », devient PR’, soit préfixe, soit préposition (comme en grec), même sens. J’élimine, dans la fin du texte, tout ce qui concerne Agrippa, la Syrie (la Palestine) et les Syriens: tous ces mots sont, d’évidence, sémites.
Et je constate donc, grâce à ce facile recensement, je l’espère, complet, que dans le passage de Philon, qui ne court pourtant que sur une dizaine de lignes (quand on en écarte les gloses), apparaissent une vingtaine de mots présents dans l’hébreu tardif à titre d’emprunts faits au grec.
Sans autres commentaires pour l’instant, je procède de même avec les parallèles du Nouveau Testament. Le gibier y est aussi abondant.
Matthieu XXVII, 27-31.
1/ stratiotaï, « les soldats », devient sous sa forme littérale ’STRTYWT, « le soldat », mais aussi « l’officier romain », « le garde », « l’estafette ».
2/ égemonos, « le gouverneur », « le guide », « le chef », devient HGMWN OU ’GMWN, « le général ».
Car qu’on y prenne bien garde : il arrive souvent qu’en se translittérant en hébreu le terme grec change radicalement de sens, ou adopte un sens plus large, ou plus étroit, selon les cas, que son modèle indo-européen. Et les traducteurs du Nouveau Testament, tous autant qu’ils sont, si aveuglement attentifs au grec, au soi-disant grec originel du corpus, n’ont pas la moindre idée de ce genre de problème ! (Que mon lecteur prenne, par contre, la peine de se référer à une traduction courante du passage de Matthieu que j’examine ici, et d’y constater, mot après mot, les écarts existant entre les phrases qu’il a sous les yeux et celles qu’aurait dû produire un recours au lexique d’emprunt : constatant ces écarts, il constatera du même coup à quelles erreurs se complaisent les soi-disant spécialistes – à une erreur, ici, en pleine Passion du Christ, de dictionnaire : rien moins.)
3/ praïtorion, « le prétoire », devient PLTWRYN, « le quartier général », « le palais ».
Pourquoi, toujours, lit-on ici, que « les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire » ? Pourquoi « le gouverneur » et pas « le général » ? Pourquoi « le prétoire » et pas « le palais » ou « le quartier général » ?
4/ olon, « tout(e) », devient ’WLW, même sens, comme préfixe ou adjectif.
5/ speiran, « la cohorte », devient ŞPYRH, « les gardes du corps lorsqu’ils sont disposés en cercle » (qu’on se rappelle que, dans Philon, la foule est disposée effectivement en cercle, en kuklo, autour de Carabas – et qu’on note la différence entre une cohorte et des gardes du corps) ; dans la Bible, ŞPYRH signifie « le diadème » (cf. Isaïe XXVIII, 5) : lien donc, ici, dans l ‘hébreu, pas dans le grec, entre les gardes et la couronne.
6/ khlamuda, « la chlamyde », devient KLMWS, « la tenue de l’officier (païen) ».
7 / kokkinén, « pourpre », devient KKL’ ou KKLN, « la pourpre », « le vêtement pourpre » (tous deux des substantifs).
8/ stephanon, « la couronne », assone avec l’hébreu biblique MŞNPŢ, « le diadème (du roi) »,
« la tiare (du grand prêtre) » ; or, je remarque qu’Ézéchiel parlant, en XXI, 31, d’« ôter la tiare (sous entendu : du grand prêtre) » emploie l’expression HSYR H MŞNPŢ ; or, HSYR,
« ôter », signifie également en hébreu « l’épine » (mais je passe, car un tel examen – celui de l’utilisation, par les rédacteurs hébreux et les traducteurs des Évangiles primitifs, de toutes sortes de jeux de mots implicites ou explicites dans l’Ancien Testament – me mènerait trop loin).
9/ akanthôn, « les épines », « l’acacia (d’Égypte, mimosa Nilotica L.) », « le chardon », n’est pas, à ma connaissance, emprunté par l’hébreu tardif. En revanche, plusieurs mots, d’emprunt ceux-là, assonent pleinement avec lui : ainsi, par exemple, DYQYNŢYN ( = grec uakinthos),
« la hyacinthe » (perle ou pierre précieuse) – on retrouverait là les effets de joaillerie rencontrés dans le récit de Philon sur Cacabas.
10/ kephalés, « la tête » : pour ce mot, je renvoie au point 2 de la liste des termes d’emprunt chez Philon.
11/ kalamon, « le calame », « le roseau », devient QLMWS, même sens.
12/ dexia, « la droite », « la main droite », est emprunté, en composition, dans des termes tels que ’PDKSYS et PRDWKSWS, qui désignent la dextérité.
13/ khaïre, « salut ! », devient KYRY, même interjection, même sens.
14/ basileu(s), « le roi », déjà rencontré chez Philon : cf. le point 10 de sa liste.
15/ Je passe sur Ioudaïon, « les Juifs », « les Judéens », calque de l’hébreu YHWDYM, mêmes sonorités, même sens.
16/ Au verset 30, sont répétés les mots kalamon, « le roseau », et kephalén, « la tête » (voir, plus haut, les remarques les concernant).
17/ Réoccurrence, au verset 31, du mot khlamuda, déjà cité.
18/ imatia, « les vêtements », « le manteau », devient ’YMTY’ ou ’NTYTYH, « le tapis de bain », « le peignoir » ; encore un fort glissement de sens qui a, jusqu’ici, totalement échappé à la sagacité des exégètes.
Autrement dit, le passage du Selon-Matthieu (XXVII, 27-31) comprend, sur un parcours de seulement 4 versets, au moins une vingtaine de termes empruntés au grec par l’hébreu tardif (postbiblique). Ce passage est donc encore plus marqué, du point de vue de son lexique d’emprunt, que celui de Philon. Si l’on en élimine les verbes,
On peut en effet les éliminer de cet examen : les verbes grecs sont peu empruntés par l ‘hébreu tardif.
on peut dire que l’ensemble des 4 versets considérés est rédigé en hébreu d’emprunt au niveau du grec qui nous en reste : c’est de l’hébreu d’emprunt en caractères grecs ! Et tous ces exégètes qui ne s’en sont jamais aperçus !… Vers eux, quelle grimace par-delà tant de siècles… Ainsi, et toujours du point de vue qui m’occupe, l’étude des passages parallèles de Marc et de Jean n’est-elle plus qu’un jeu d’enfant :
Marc xv, 16-20.
Comme en Matthieu, et dans les mêmes termes, on trouve chez Marc : les soldats, le palais, toute la cohorte, la couronne et les épines, salut roi des Juifs (ou des Judéens – je tiens à cette impérative distinction), la tête, le roseau, et les vêtements.
Tous ces mots sont d’emprunt!
Ne me reste plus que :
porphuran, « la pourpre » (au lieu, ici, de kokkinén),
Le fait que nous ayons ici et là deux termes, selon les versions, pour désigner
« la pourpre », prouve (n’indique pas, et ne suggère pas : prouve) que l’original était un mot sémite pur, et non un emprunt : face à cet original unique, les traducteurs ont hésité entre les deux termes d’emprunt figurant dans leur lexique (et dans leur cerveau). Sans doute y avait-il ’RGMWN dans le texte premier, comme je le montrerai plus tard. qui, en hébreu tardif, devient PWRPWR’, « la pourpre », « le vêtement pourpre » (substantif)
- terme qui assone joliment avec l’hébreu d’emprunt PPYYR (déjà rencontré), « le papyrus » (encore un lien avec le récit de Philon).
4, Jean XIX, 2-3.
Comme en Matthieu et Marc, on trouve chez Jean, dans les mêmes termes, les soldats, la couronne et ses épines, la tête, le vêtement, la pourpre, et salut roi des Juifs (Judéens) – tous ces emprunts en deux versets !
Et ne me reste plus que :
rapismata, « les coups (au visage) », mot qui, sans emprunt aucun, assone aussitôt avec la racine sémite pure RPS, même connotation, racine qui, bizarrement, forme anagramme, aussi bien en grec que via l’hébreu, avec les paraséma (« les insignes ») du texte de Philon!
Même conclusion que précédemment, même pléthore de termes d’emprunt en Marc et Jean que chez Matthieu. Même injure aux exégètes en titre et à leur thèse d’une rédaction grecque des Évangiles produite par des semi-illettrés, et surtout à la bête théorie selon laquelle ces Évangiles auraient été écrits en koïné, en grec hellénistique et populaire: une koïné sémite !!… ils ne reculent devant rien, nos érudits théologues.
Et tout ceci alors que nos passages, essentiels dans le Christianisme, sont sémites de part en part en tant que narrations :
Il ne s’agit pas d’une petite parabole dissimulée dans un recoin de l’édifice, mais de la « Passion du Christ », n’est-ce pas ?
- syntaxiquement, comme l’extrême majorité des versets des Évangiles, des Épîtres et de l’Apocalypse (dite de Jean), du fait de l’ordre des mots qui s’y exhibe, du peu de complexité des propositions, de leur uniforme liaison par la copule « et » (grec kaï traduisant l’hébreu W), etc., au point que traduire (je ne dis pas : rétrovertir) leur grec en hébreu paraît tout du long, grammaticalement, très facile ;
- et sémantiquement, du fait que leurs substantifs appartiennent massivement au vocabulaire d’emprunt des monuments les plus inévitables du Judaïsme (Targums, Talmuds, Midrashim) – point de vue exhaustif (car quoi, dans un texte, linguistiquement, hors la syntaxe et le vocabulaire ?) qui élimine tout recours, précisément, à la koïné : a-t-on vu un Polybe, expert, dit-on, ès ladite koïné, calquer son grec sur l’hébreu et user d’un vocabulaire emprunté par les Juifs au détriment, comme ici, de tout autre ?
Et puis – et surtout – a-t-on jamais vu, chers amis les théologues, des pratiqueurs de koïné produire des jeux de mots ne se comprenant et ne se savourant, comme ici, que par un impératif recul (rétrovertif) vers l’hébreu ?
Qu’on en juge plutôt :
Matthieu (XXVII, 27) dit que les acteurs de la scène sont les soldats du général, de l’égemon. J’ai déjà noté que ce mot est, à l’exception de tout autre, emprunté par l’hébreu tardif sous les formes ’GMWN et HGMWN avec le sens de « général d’armée ».
Tiens, en passant, Pilate était-il donc un général ?
Jésus est amené au praïtorion, c’est-à-dire, et en dépit des traductions et des traditions européennes et ecclésiastiques courantes, et via l’emprunt PLTWRYN, au palais (c’est bien la version de Marc aussi : eso tés aulés, « à l’intérieur du palais » – et non pas « de la cour » puisque la glose, par recours à l’emprunt, élimine ce sens). Or, l’un des mots hébreux les plus communs pour désigner le palais est HRMWN (autre graphie: ’RMWN), mot qui a, dans les deux cas, quatre lettres sur cinq, dans l’ordre, identiques à celles du « général », et qui subit le même flottement graphique (entre H et ’) que lui.
On revêt Jésus/Josué/Dieu-salvateur d’un vêtement de pourpre. Un seul terme hébreu pour désigner la pourpre : ’RGMN, mot qui a quatre lettres sur cinq, dans l’ordre, communes avec
« le général » et avec « le palais ».
Et personne ne l’a jamais vu ! – Et ce n’est pas encore fini :
On donne à Jésus un calame, un roseau. Le roseau se dit en hébreu QNH, ou… ’GMWN, ce dernier mot ayant, dans l’ordre, cinq lettres sur cinq communes avec « le général » et, toujours dans l’ordre, quatre lettres sur cinq communes avec « la pourpre » et avec « le palais ».
Ces jeux de mots, absolument invisibles – indevinables ! – dans le grec qui nous reste (égemon, praïtorion, kokkinos/porphura et kalamos ne produisent pas d’assonances), ne sont opératoires qu’en vertu d’un nécessaire recours à l’hébreu d’origine : en bref, seule l’hypothèse d’un original sémite, traduit ensuite en grec très littéralement (le grec, seul, nous restant), peut rendre compte de ces cascades d’assonances et de jeux de mots – maladie incurable, selon les uns, et merveille des merveilles, selon les autres, de la littérature hébraïque traditionnelle, l’une de ses caractéristiques essentielles en tout cas.
Cette remarque ne vaut bien évidemment pas que pour les passages considérés et étudiés ici (ceux de la Passion) : le Nouveau Testament et une partie très importante de la littérature apocryphe (ou dite telle), grecque, Copte, etc. exhibent les mêmes sortes de jeux de mots sous-jacents, c’est-à- dire : ne fonctionnant ni en grec ni en copte, etc., mais uniquement grâce à un nécessaire recours à une rétroversion vers l’hébreu (leur hébreu d’origine). Le plus souvent, les traducteurs de ces textes, tout en conservant au mieux la syntaxe de leur original, ont perdu, au niveau du vocabulaire, du choix des mots de leurs traductions, la saveur et le sens des assonances, des sous- entendus, des anagrammes et des calembours primitifs – assonances, sous- entendus, anagrammes et calembours dont sont si singulièrement riches les textes de la littérature hébraïque, biblique ou non.
Et, dans cette hypothèse, la seule possible, je puis me mettre un instant dans la tête des traducteurs anciens. Dans l’original de Matthieu XXVII, 27, ceux-ci ont affaire soit à ’GMWN (ou, autre graphie, HGMWN), et dans ce cas ils n’ont aucun effort à fournir pour lui trouver un équivalent grec : il leur suffit de rétablir égemon, original même de cet emprunt – soit à un terme proprement et purement sémite, ŜR, ou NGYD, ou autre, autrement dit à un terme hébreu pur désignant un chef, un prince, un guide, un général : dans ce dernier cas, quel mot grec vont-ils choisir décidément ? Tout les pousse à opter pour égemon, et pour lui seulement : tout d’abord le fait que ce mot a un sens apparenté au terme sémite à traduire ; ensuite le fait que ce mot, et lui seul avec ce sens, figure dans leur esprit (dans leur lexique) comme un terme acclimaté en hébreu à titre d’emprunt manifeste au grec ; et enfin le fait que la suite du passage à traduire contient des termes, eux uniquement sémites purs, là, sous leurs yeux, qui assonent parfaitement avec ce terme d’emprunt, à savoir, comme je l’ai montré plus haut, « le palais », « la pourpre », et « le roseau ».
Là encore on peut et doit sans crainte élargir le problème et sortir, un instant, des seuls passages étudiés ici. J’ai relevé dans le dictionnaire de Jastrow et dans le Lehnwörter de Krauss des dizaines et des dizaines de termes empruntés (par l’hébreu tardif au grec) qui trônent en bonne ou en très bonne place dans le lexique du Nouveau Testament. Ils s’y pavanent en foule et personne n’a jamais étudié les caractéristiques et surtout les implications de cette pavane-là. Or, qu’on y songe encore, certains de ces mots sont empruntés au grec tout en conservant comme emprunts, sous alphabet hébraïque, leur signification-connotation grecque originale, mais d’autres – en très grand nombre – ou bien perdent une part importante du sens grec primitif, ou bien le perdent tout entier : dans ce dernier cas, le sens de l’emprunt n’a plus rien à voir avec celui de l’emprunté ; mais alors le lecteur du Nouveau Testament tombant – à chaque pas ! – sur ces mots, sur des mots de ce genre, doit les lire non pas avec leur sens grec (pur) mais avec celui-là seul qu’ils possèdent à titre d’emprunts – et voilà, du coup, remise en cause 1’intelligence de pans entiers du corpus canonique ! Ce qui veut dire, encore plus concrètement : qu’il faut se méfier des traductions françaises, anglaises, allemandes, et autres, de ce corpus (aussi bien, dès lors, des fidèles que des infidèles, puisque toutes ne se réfèrent fautivement qu’au dictionnaire grec pur), et, d’autre part, qu’il faut jeter aux oubliettes des milliers et des milliers de pages et de volumes de commentaires sur ce même Nouveau Testament, commentaires produits à partir de l’examen grec de son seul grec sur la base de la seule sémantique grecque : cela promet de beaux autodafés, salutaires cette fois, et de belles épargnes…
Les traducteurs antiques ont donc ici, tout bonnement, opté pour la solution la plus directe, la plus littérale, la plus commode surtout – la plus accessible. Et tout ceci contribue à condamner la thèse absurde d’une rédaction grecque originelle des passages considérés.
Et tout ceci ouvre enfin la question essentielle, l’unique question intéressante : qu’en était-il du texte sémite originel ? Qu’en était-il de cette narration-là ? – Faudra-t-il vraiment chausser des bottes de sept lieues pour l’atteindre ou, plus modestement, l’approcher ?
